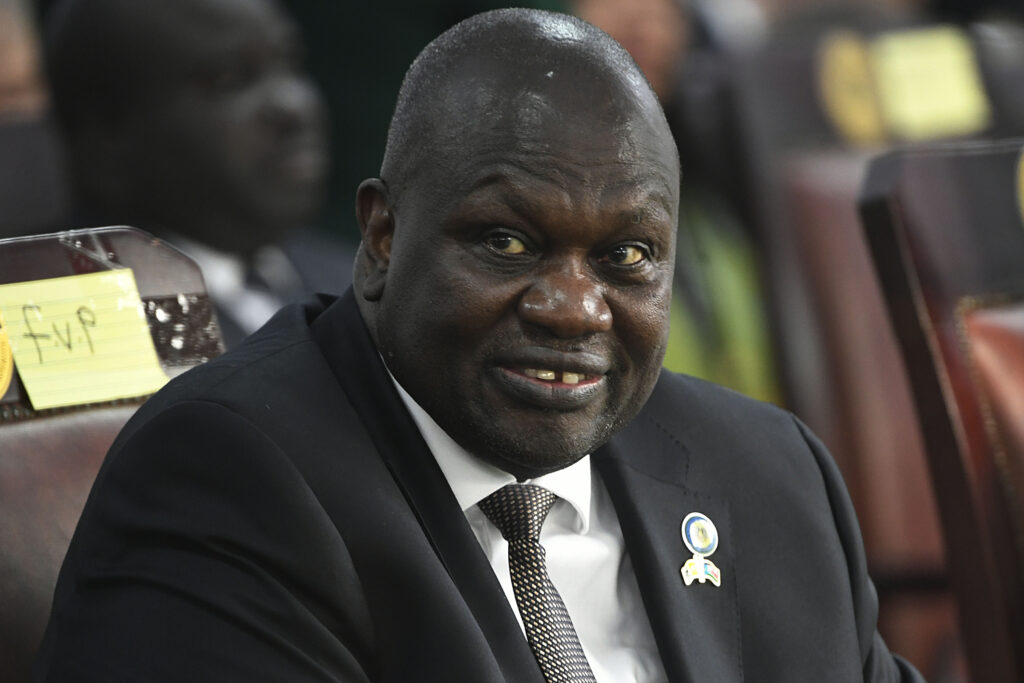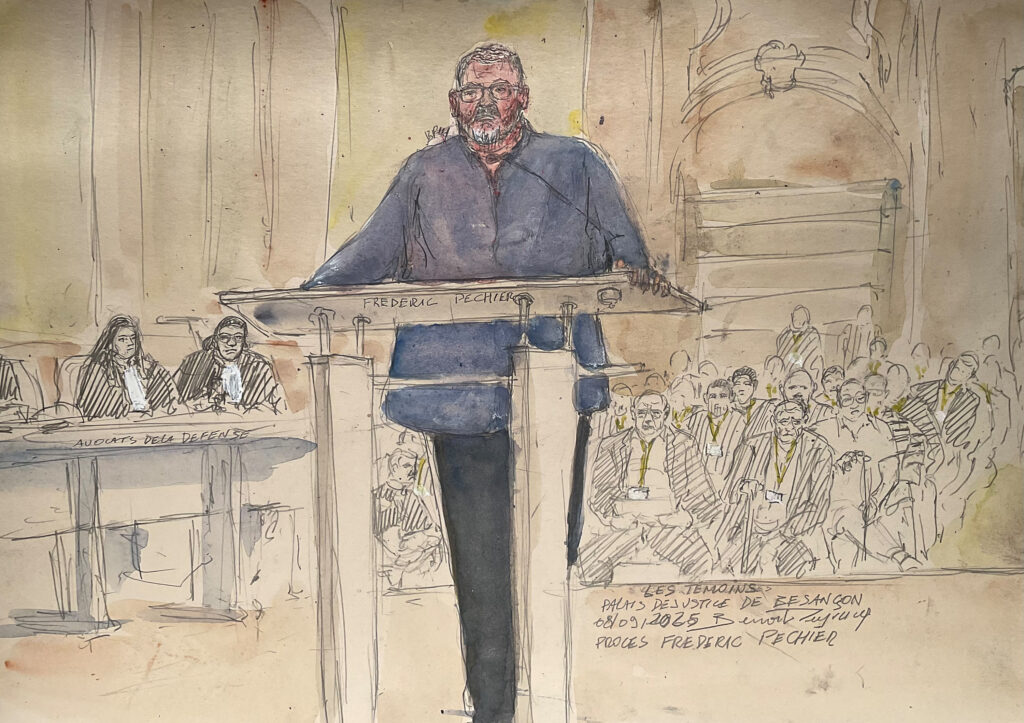Triple record à Wall Street, poussée par les perspectives de baisses des taux
La Bourse de New York a touché des sommets en clôture jeudi, alors que des nouveaux indicateurs économiques sont venus conforter les attentes des investisseurs quant à un assouplissement monétaire de la Fed.Les trois indices vedettes de Wall Street ont terminé sur de nouveaux records: le Dow Jones a gagné 1,36% à 46.108,00 points, l’indice Nasdaq a progressé de 0,72% à 22.043,07 points et l’indice élargi S&P 500 a avancé de 0,85% à 6.587,47 points.”Le marché pousse un soupir de soulagement”, commente auprès de l’AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.En cause: “les données économiques sur l’emploi (…) renforcent les probabilités d’une baisse des taux d’intérêt d’ici la fin de l’année et au-delà”, résume Jose Torres, d’Interactive Brokers.Les investisseurs ont porté leur attention sur les demandes hebdomadaires d’allocations chômage, qui sont ressorties au plus haut depuis 2021.Ces dernières ont accéléré à 263.000, alors que les analystes s’attendaient à une stabilisation.L’indice des prix à la consommation d’août est, lui, ressorti en hausse de +0,4% sur un mois, après +0,2% en juillet, selon le ministère américain du Travail, soit légèrement au-dessus des attentes du marché.Sur un an, l’inflation a aussi accéléré à +2,9%, contre +2,7% un mois plus tôt, un chiffre cette fois en ligne avec les prévisions des analystes.La grande majorité des acteurs du marché estiment toutefois que la banque centrale américaine (Fed) baissera ses taux d’un quart de point lors de sa prochaine réunion prévue les 16 et 17 septembre.Non pas parce que l’inflation semble en passe d’être maîtrisée, mais parce que le marché du travail paraît fragile, un point d’attention qui fait aussi partie du mandat de l’institution.Les investisseurs s’attendent également à des baisses lors des réunions d’octobre et de décembre, qui ramèneront les taux dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.”Si la Fed baisse ses taux, le coût des activités commerciales diminue”, ce qui “stimule à la fois l’économie réelle et Wall Street”, souligne M. Sarhan, d’où l’enthousiasme de la place new-yorkaise.”Cependant, la Fed va agir (…) en évaluant les risques et les avantages” tout au long du processus, ajoute l’analyste.Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d’Etat américains à échéance 10 ans se détendait par rapport à la clôture mercredi, à 4,02% vers 20H15 GMT contre 4,05%.Au tableau des valeurs, le groupe de médias Warner Bros Discovery a été propulsé (+28,95% à 16,17 dollars) après des informations de presse assurant que son concurrent Paramount Skydance pourrait le racheter, et former ainsi un mastodonte du divertissement.Selon le Wall Street Journal, Paramount Skydance (Nickelodeon, MTV, Paramount) serait prêt à s’emparer de la majorité des actions du conglomérat rassemblant entre autres le studio de cinéma Warner Bros et les chaînes de télévision HBO et CNN. L’action Paramount Skydance s’est envolée de 15,55% à 17,46 dollars.Le spécialiste suédois du paiement fractionné Klarna (-6,15% à 43,00 dollars) a été boudé pour son deuxième jour de cotation à Wall Street.Son introduction en Bourse, très attendue, lui a permis de lever plus d’un milliard de dollars.Le géant technologique Oracle a perdu du terrain (-6,25% à 307,82 dollars) après son envolée de la veille, provoquée par des prévisions colossales pour ses centres de données.