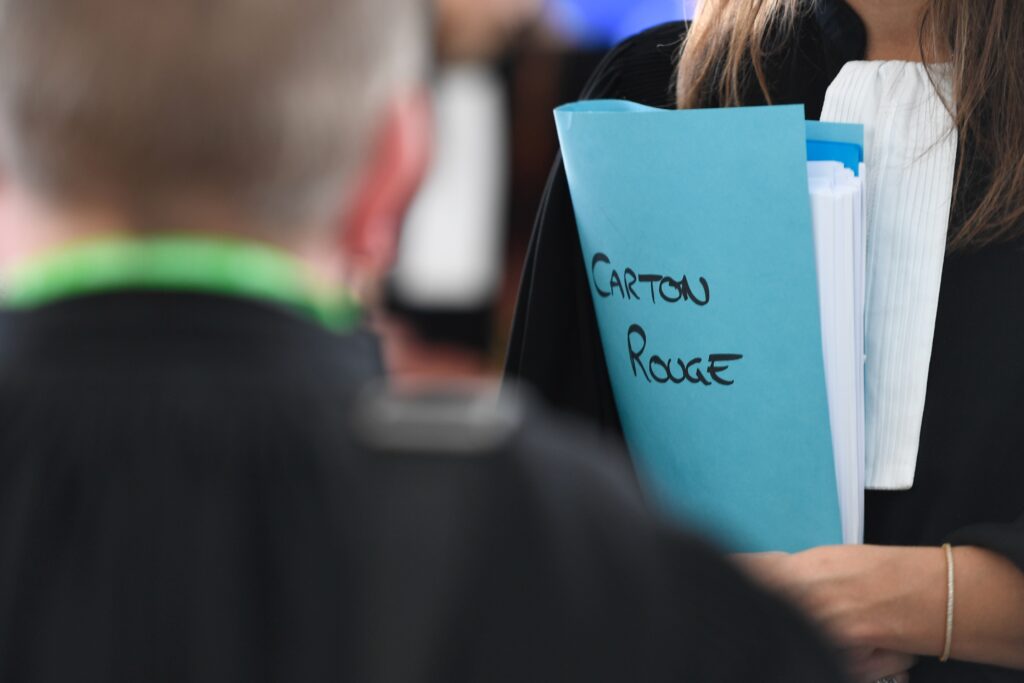“Je ne peux pas produire à ce prix-là”: le plus gros maraîcher du Grand Est cesse sa production
C’était le plus grand maraîcher du Grand Est : à Balgau (Haut-Rhin), Claude Keller, patron de l’entreprise ID3A, a décidé de mettre fin à son activité, essoré par l’impossibilité de vendre au juste prix ses légumes à la grande distribution.En 2024, sur 220 hectares de terres cultivées, l’entreprise a produit plus de quatre millions de salades, 1,5 million de bottes de radis, 320.000 choux blancs, 800 tonnes de navets, et encore des centaines de tonnes de persil et de céleri à destination des supermarchés français.Toutefois, dans les frigos grands comme des hangars et sur les champs qui s’étendent à perte de vue, pas un légume ne subsiste aujourd’hui. Au bord des parcelles, des montagnes de palettes et de cageots vides témoignent d’une époque désormais révolue.Les machines sont rachetées par des producteurs étrangers, les terres légumières vont être reconverties en grandes cultures (blé, orge, maïs) pour l’alimentation animale. Les supermarchés, eux, iront se fournir ailleurs.”On est en semaine 13 sur le calendrier. Normalement on aurait dû planter 50.000 batavias, 10.000 laitues, 25.000 feuilles de chêne blondes, et trois hectares de radis”, explique le chef d’entreprise en montrant les plannings de production de l’année précédente, restés accrochés sur de grands tableaux.Au lieu de ça, la PME a mis en place un plan de cessation d’activité, et licencie son personnel. Elle employait une douzaine de permanents et jusqu’à 70 saisonniers, soit 49 équivalents temps plein.- “Cadeau empoisonné” -La décision de mettre fin à cette activité entamée il y a 35 ans n’a pas été facile à prendre. “C’est des semaines et des mois où vous ne dormez pas la nuit”, témoigne l’agriculteur de 59 ans, qui a monté la société avec son père et y a fait toute sa carrière.”J’ai un fils qui nous a rejoint il y a un an, et je ne me voyais pas lui transmettre une entreprise comme ça. C’était un cadeau empoisonné”.A l’origine de ses difficultés, l’impossibilité de faire accepter à ses clients, les centrales d’achat des grandes surfaces, des hausses de prix pour répercuter “l’explosion des charges”, principalement l’augmentation du coût de l’énergie, des produits phytosanitaires et du transport.”Il y a un problème dans la filière”, analyse-t-il. “Personne n’a la droit de vendre à perte, que ce soit le grossiste, le distributeur, le magasin, ça paraît logique. Il n’y a qu’un seul maillon où on tolère la vente à perte, c’est nous, les producteurs, parce qu’on ne se base jamais sur le prix de revient, on ne parle que du prix du marché.”Ainsi en 2024, il a été contraint de vendre pendant des semaines ses salades à 50 centimes l’unité, quand elles lui coûtent 75 centimes à produire. “On a des produits frais, fragiles, on ne peut pas les stocker. C’est à vendre tout de suite ou alors c’est foutu. Ils jouent sur ce rapport de force, et nous on n’a pas le choix”.Il pointe la responsabilité des enseignes de la grande distribution et souligne le décalage entre le discours volontariste des grands patrons médiatiques et le comportement des directeurs de magasins, “qui mettent la pression”.- Concurrence des petits -Mais il n’élude pas non plus les limites du monde agricole. “Nous ne sommes que des petites PME, nous ne sommes pas organisés”, déplore-t-il, regrettant que l’interprofession n’ait “jamais réussi à mettre en place un bureau d’achat pour peser plus lourd dans les négociations”.Au final, il subit “la concurrence de petits producteurs, qui ne connaissent pas leurs prix de revient”, acceptent de baisser les prix et vendent à perte sans le savoir. “Tant que le prix de revient ne sera pas à la base de l’élaboration du prix de vente, je ne vois pas de sortie à notre problème”.Les grandes réformes, dont les lois Egalim, visant à protéger la rémunération des agriculteurs face à la grande distribution, n’y ont rien changé. “On pensait que ça nous aiderait, mais ça n’a pas été le cas. C’est le consommateur qui décide s’il achète nos produits, c’est lui qui a le pouvoir”.Pour son fils Léo, 24 ans, qui s’apprête à prendre la relève, l’arrêt du maraîchage laissera une petite cicatrice: “ça m’a fait mal au début”, confie-t-il sous sa casquette verte. “Mais j’ai pris conscience que c’était la meilleure chose à faire”.