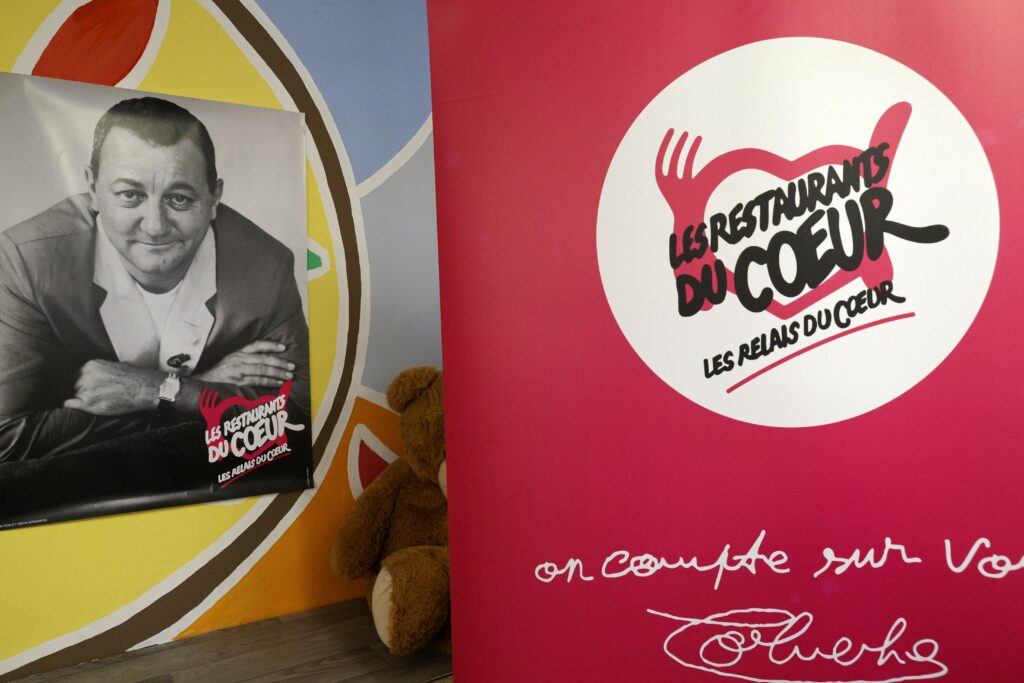TotalEnergies visé par une plainte pour “complicité de crimes de guerre” au Mozambique
TotalEnergies est visé à Paris par une plainte pour “complicité de crimes de guerre, torture et disparitions forcées” au Mozambique, pour des faits datant de 2021 sur le site de son méga-projet gazier qui était alors à l’arrêt, a appris mardi l’AFP de l’ONG plaignante.L’association allemande European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) accuse le groupe français d'”avoir directement financé et soutenu matériellement la Joint Task Force (JTF), composée de forces armées mozambicaines, alors que celle-ci aurait détenu, torturé et tué des dizaines de civils” entre juillet et septembre 2021, selon son communiqué de presse.Ces exactions se seraient produites à l’entrée du site du projet gazier Mozambique LNG, dont TotalEnergies est le premier actionnaire (26,5%) et l’opérateur, et qui était alors en pause après une attaque jihadiste meurtrière en mars 2021 sur la ville voisine de Palma (nord). La plainte a été transmise lundi au parquet national antiterroriste (Pnat) à Paris, compétent pour les crimes de guerre.Elle fait suite à des allégations rapportées par le média Politico en septembre 2024, puis par SourceMaterial et Le Monde, et que TotalEnergies conteste.Contacté mardi par l’AFP, TotalEnergies n’a pas commenté dans l’immédiat. “Il apparaît impensable que TotalEnergies puisse opposer son ignorance des crimes de l’armée mozambicaine, mais aussi plus particulièrement des accusations de violations des droits humains visant la Joint Task Force, dès lors que la société les rapporte elle-même dans plusieurs documents internes transmis à ses financeurs publics”, affirme à l’AFP Clara Gonzales, directrice du programme entreprises et droits humains à l’ECCHR.Cette plainte intervient alors que le géant des hydrocarbures français s’est dit prêt le 25 octobre à relancer le projet du consortium Mozambique LNG estimé à 20 milliards de dollars, en vue d’un début de production en 2029.Après l’attaque de jihadistes liés au groupe Etat islamique, actifs dans la province du Cabo Delgado depuis 2017, le groupe français avait déclaré la “force majeure” et suspendu son projet, en avril 2021. Le site avait alors été laissé sous la garde des forces de l’armée mozambicaine, regroupées dans la JTF, créée en 2020 en vertu d’un accord entre la filiale locale de TotalEnergies, Tepma 1, et le gouvernement de Maputo. Cet accord est interrompu en octobre 2023. – “Nouveaux” éléments -Selon Politico, lors de leur contre-offensive contre les jihadistes, des soldats travaillant pour le site ont intercepté des habitants et enfermé entre 180 et 250 hommes dans des conteneurs, les accusant de soutenir l’insurrection. Détenus pendant trois mois, ils ont été battus, affamés et torturés, et plusieurs ont été tués. Les 26 derniers prisonniers sont libérés en septembre 2021, selon l’enquête du journaliste Alex Perry, sur la foi de témoignages.Mozambique LNG avait alors assuré n’avoir “jamais reçu d’information indiquant que de tels événements aient effectivement eu lieu”. Par la suite, la société a indiqué avoir demandé en novembre 2024 aux autorités mozambicaines de diligenter une enquête, officiellement annoncée en mars 2025 par le bureau du procureur général. Au même moment, la Commission nationale des droits humains confirmait lancer ses investigations, comme sollicité par TotalEnergies fin 2024. Selon l’association ECCHR, TotalEnergies était “au courant” de violations de droits humains par les forces armées.Le Monde et Source Material avaient affirmé en novembre 2024 que TotalEnergies avait, dès avril 2021, connaissance d’accusations d’actions violentes de la JTF sur des civils, selon des rapports sociaux émanant des équipes de Mozambique LNG et transmis à l’agence italienne de crédit à l’exportation (SACE), qui soutient le projet.Or pour l’ONG, “TotalEnergies a continué de soutenir directement la JTF” en fournissant logement, nourriture et des primes “conditionnées au respect des droits humains”.ECCHR avance aujourd’hui de “nouveaux documents” obtenus auprès des autorités néerlandaises, qui font état d’échanges entre l’agence hollandaise de crédit à l’export publique Atradius DSB et TotalEnergies, évoquant dès mai 2020 des risques d’atteintes aux droits humains des forces armées. Selon l’ONG, deux enquêtes d’agences de crédit à l’export ont été ouvertes.Cette plainte doit “être entendue comme un message par les financiers publics et les banques telles que Société générale et Crédit agricole pour qu’ils engagent leur retrait immédiat du projet”, a réagi auprès de l’AFP, Lorette Philippot, des Amis de la Terre France, qui s’oppose à “l’expansion gazière au Mozambique”.